Le voyage de ce mois-ci dans le programme ECOP de la Décennie de l'océan nous amène dans l'État du Bengale occidental, à la frontière orientale de l'Inde, où est basée la Fondation Prameya. Créée en 2016, cette organisation de conservation de l'environnement à but non lucratif favorise la durabilité environnementale par l'autonomisation des communautés.
La Fondation Prameya a été fondée par un groupe de jeunes voyageurs issus de différents milieux professionnels, qui ont tous pris conscience de la situation critique des communautés locales dans les endroits les plus vulnérables au changement climatique. Mukut Biswas, fondateur, administrateur délégué et directeur exécutif, et Arunava Ghosh, cofondateur, communication de masse et médias sociaux, partagent avec nous leur expérience et leurs aspirations.
- Quelle est la situation actuelle de l'écosystème des mangroves des Sundarbans en Inde ? Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de ces écosystèmes ?
Les mangroves des Sundarbans constituent un écosystème hautement protégé et sont classées comme site Ramsar. En outre, la réserve de tigres des Sundarbans, située dans ce site, fait partie de l'"habitat critique du tigre" protégé par les lois nationales et constitue également un "paysage de conservation du tigre" d'importance mondiale. Les Sundarbans sont le seul habitat de mangrove à abriter une population importante de tigres, qui possèdent des compétences uniques en matière de chasse aquatique. Les forêts de mangroves protègent l'arrière-pays des tempêtes, des cyclones, des raz-de-marée, ainsi que des infiltrations et intrusions d'eau salée à l'intérieur des terres et dans les cours d'eau. Elles servent de nurseries aux crustacés et aux poissons et soutiennent la pêche de toute la côte orientale. Tous ces facteurs réunis font des Sundarbans une masse continentale importante sur le plan écologique et économique.
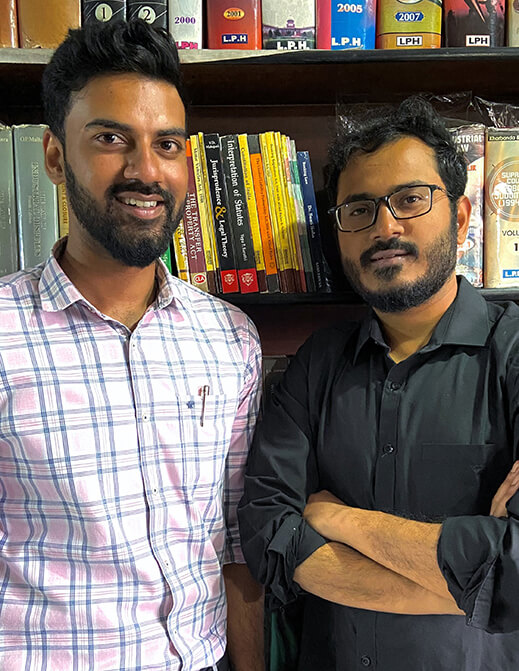
- Quelles sont les pressions les plus importantes perçues par les communautés locales avec lesquelles vous travaillez étroitement ?
Tout d'abord, la fréquence des cyclones et les régimes pluviométriques erratiques ont perturbé la vie et les moyens de subsistance des communautés qui survivent dans la région des Sundarbans, ajoutant aux pertes agricoles brutes. Ces schémas sans précédent ont laissé à ces communautés une très petite fenêtre pour se remettre des tempêtes précédentes jusqu'à ce qu'une autre frappe. Cela a conduit à une migration massive de la communauté vers les villes voisines.
Deuxièmement, le changement de la salinité de l'eau de la rivière, qui s'est produit au cours des quatre dernières années, comme l'ont indiqué les pêcheurs locaux, a entraîné une perte massive de poissons, ce qui a provoqué des pertes économiques supplémentaires au sein de cette communauté déjà vulnérable.
- D'après votre expérience, comment pouvons-nous faciliter une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature ? Comment cette relation fondamentale se manifeste-t-elle dans votre région ?
Nous pensons que l'homme et la nature doivent coexister harmonieusement, ce qui constitue le principe de base du développement durable. Mais cette relation s'érode au rythme de l'épuisement des ressources naturelles, de la réticence à mettre en œuvre les accords internationaux multilatéraux sur l'environnement et de la dilution des lois nationales sur l'environnement.
La Fondation Prameya vise à conserver les connaissances traditionnelles et à les transmettre à la génération actuelle. Cela facilitera automatiquement une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, en mettant l'accent sur la conservation de la faune et de la flore, les techniques modernes et durables de pêche, l'apiculture, l'écotourisme, l'extension des forêts, la diversification des emplois, l'autonomisation et les moyens de subsistance des femmes, pour n'en citer que quelques-uns.

- Quelle est l'importance de l'autonomisation des communautés dans les projections de restauration des écosystèmes ? Comment l'appliquez-vous dans votre travail à la Fondation Prameya ? Avez-vous des conseils à donner ?
Nous avons tous compris qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver les zones de biodiversité de la planète et les communautés indigènes du monde entier ont un rôle vital à jouer. Depuis des millénaires, ces communautés du monde entier maintiennent un équilibre judicieux entre leurs besoins et les besoins correspondants de la nature et vivent en "harmonie avec la nature". Ces communautés contribuent le moins au changement climatique mondial mais sont les plus touchées par ses conséquences. Leur rôle vital dans la protection de la nature est souvent sous-estimé, et nombre de ces communautés n'ont pas non plus accès aux services de base tels que l'éducation, la santé, un logement correct et des possibilités d'emploi. Sans une protection adéquate et une amélioration de leur niveau de vie, aucun objectif de conservation ne pourra jamais être atteint.
Ainsi, les efforts de conservation de la Fondation Prameya sont basés sur la communauté, se concentrant sur l'amélioration de l'accès aux services de base et à l'autosuffisance par le biais de l'éducation communautaire et de projets d'autonomisation, tels que la création d'éco-villages autosuffisants, préservant ainsi la nature et ses ressources.
- La participation des jeunes, des femmes et des communautés locales autochtones est au cœur de vos activités. Pourquoi est-ce si important pour vous et quelles sont les initiatives dont vous êtes le plus fier ?
Nous pensons que les jeunes, les femmes et les communautés locales indigènes sont les plus puissants alliés de la nature. Leur relation avec la boue, les mangroves et la faune fait d'eux un aspect important de nos activités de conservation. Sans leur soutien ou leur participation, la conservation de la région des mangroves serait une tâche herculéenne.
Une initiative dont nous sommes particulièrement fiers est la Prameya Mangrove Nursery - qui est une initiative communautaire de collecte de propagules de palétuviers et de leur stockage et plantation ultérieurs. Il s'agissait au départ d'une pépinière de mangroves à petite échelle, avec l'aide d'écoliers, qui s'est transformée en un mouvement de masse dans le village de Tridipnagar, Jharkhali, dans les Sundarbans. Nous avons réussi à conserver et à restaurer les mangroves sur une superficie de 2 hectares, qui continue de s'étendre. Ce mouvement a également été reconnu et apprécié par le gouvernement et les organismes quasi-gouvernementaux. À l'heure actuelle, le village tout entier s'est donné la main pour créer une pépinière dans chaque foyer. Cela a permis de protéger la vie des villageois contre les cyclones sans précédent qui ont frappé la côte sud du Bengale ces dernières années.

- Selon vous, que peuvent apporter les communautés côtières locales aux processus de politique marine et comment pouvons-nous les impliquer dans la Décennie des Nations unies pour l'océan ?
Les voix des communautés locales ont longtemps été ignorées et laissées sans écho. Le moment est venu de donner à ces communautés les moyens d'agir - à la fois en leur fournissant des ressources et en leur conférant un pouvoir juridique - afin de créer un environnement où les hommes et la nature peuvent prospérer ensemble. La Décennie des Nations unies pour l'océan sera l'occasion idéale d'impliquer les communautés côtières locales dans la surveillance et la gestion des ressources naturelles en leur fournissant la formation requise, les connaissances scientifiques modernes, le soutien technologique et les fonds nécessaires.
- Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés en tant que jeune organisation à but non lucratif ?
En tant que jeune organisation à but non lucratif, les défis sont variés. Tout d'abord, nous n'avons pas la visibilité et l'identité requises, ce qui nous a empêché de gagner la confiance des autorités statutaires opérant dans la région. Deuxièmement, et c'est le plus important, nous n'avons pas accès aux fonds nécessaires pour faciliter l'organisation de divers programmes de renforcement des capacités, de séminaires, d'ateliers et d'échanges de connaissances avec la communauté marine côtière.
- Si vous étiez un représentant en début de carrière à la conférence des Nations unies sur les océans de 2022, que proposeriez-vous pour obtenir l'océan que nous voulons d'ici 2030 ?
Saisissant l'opportunité d'être un représentant en début de carrière, nous aimerions proposer la promulgation d'un traité international et/ou d'un accord international multilatéral sur l'environnement qui traiterait spécifiquement des problèmes plus larges des déchets plastiques générés par les engins de pêche ou les filets fantômes, ainsi que des effets dévastateurs des prises accessoires, des pratiques de pêche illégales et de l'exploitation des travailleurs dans les navires de pêche. Dans le même temps, nous devrions également mettre en œuvre des pratiques de pêche durables efficaces.

- Quelles sont les possibilités offertes aux ECOP qui souhaiteraient participer à vos activités au sein de la Fondation Prameya ?
La Fondation Prameya travaille en étroite collaboration avec les communautés côtières locales afin de fournir une expérience de première main dans la compréhension et la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées, notamment en ce qui concerne la dévastation causée par des tempêtes cycloniques sans précédent. Les programmes en cours de collecte de propagules de mangrove et d'expansion de la pépinière de mangrove permettront aux ECOP de connaître les espèces de mangrove présentes et conservées dans la région.
La Fondation est également impliquée dans l'organisation de plusieurs ateliers visant à éduquer la communauté sur les techniques de pêche durable, qui à leur tour peuvent fournir aux ECOP une meilleure compréhension des problèmes émergents de pratiques de pêche illicites, que la Fondation traite dans la région.
Nous avons également une grande portée dans les Sundarbans indiens, ce qui peut encourager les ECOP à rencontrer des personnes de différentes professions et à comprendre leur vie et leurs moyens de subsistance.